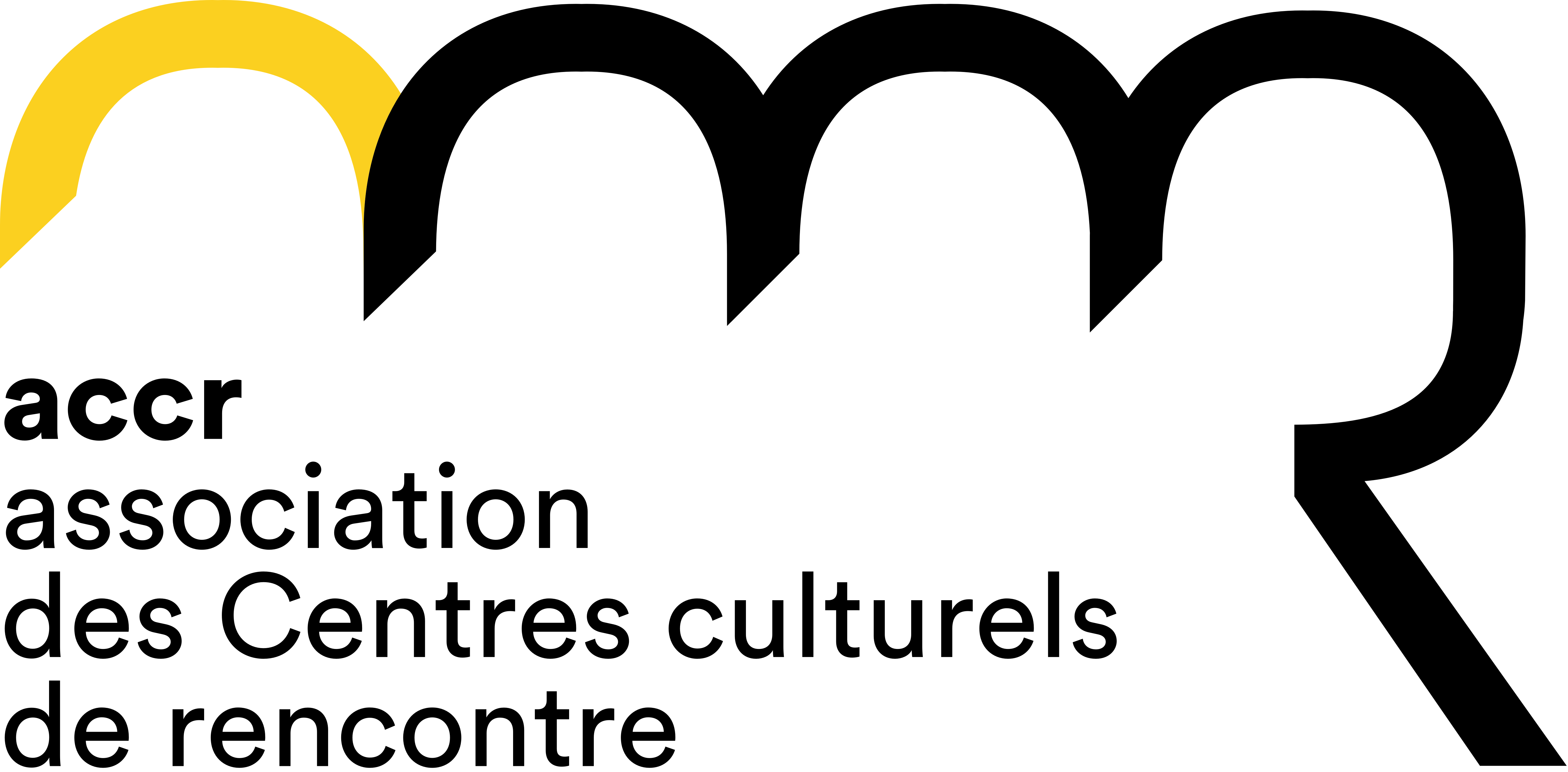Du 26 au 29 mai 2025, s’est déroulé le premier voyage d’étude organisé par le CCR d’Ambronay au château de Žďár (membre associé de l’ACCR en République tchèque) dans le cadre d’un programme Erasmus+ sur les enjeux de tourisme et de durabilité.
Cette mobilité a notamment permis de découvrir le modèle du château de Žďár qui associe valorisation des patrimoines et des cultures ainsi que sensibilisation et préservation de l’environnement. Les échanges ont ainsi permis de questionner une approche durable et éthique de la nature et du patrimoine, ainsi que d’interroger des notions relatives à la gestion des patrimoines que sont la transmission, la responsabilité partagée, la préservation ou encore la coopération.
Parmi les sujets évoqués, a été déployée la notion d’expérience de visite à partir du postulat qu’il n’existe pas un tourisme international face à un public local mais uniquement des habitant.es du territoire ou des habitant.es de passage, plus ou moins bref.
La complexité de la gestion des activités du château de Žďár a ainsi été appréhendée : activités artistiques dans et hors les murs, valorisation des patrimoines et de l’histoire des lieux, lien avec des partenaires publics et privés, propositions culturelles à l’année, … Chacune a son rythme et doit s’aligner avec les autres.
/ L’esprit des lieux
L’évolution du château de Žďár a été pensée en accord avec l’esprit des lieux, initialement à vocation religieuse. Lors des travaux, a été décidé que le musée ainsi que le café, soit les activités commerciales, se trouveraient aux extrémités du site, quand le coeur du lieu accueillera le centre de création chorégraphique, soit le lieu du silence, de l’introspection et de la réflexion.
Les équipes se sont ainsi attelées à modeler un site où les différentes activités et vocations premières dialoguent entre elles et se nourrissent mutuellement. Par exemple, le musée est une source d’inspiration pour l’événementiel, l’audioguide du musée est un dialogue réalisé par des comédiens pour approcher l’esprit du lieu, la muséographie a été travaillée avec des artistes du spectacle vivant et des professionnel.les du cinéma, …
/ Repenser les relations
Culture du faire ensemble et responsabilité partagée sont deux notions qui ont accompagné les participant.es lors de la mobilité. La création, le maintien et la formalisation du lien entre un site et les habitant.es ont ainsi été discutés et plusieurs moyens pour y parvenir évoqués : mise en place d’un club des ami.es, d’un club des donateur.rices, animation active d’une communauté des bénévoles avec des moments et offres dédiés, attention portée à l’écoute des attentes des personnes dans une relation de confiance et de considération mutuelle, explicitation des choix de médiation retenus, co-construction de projets, …
De fait, le château de Žďár a partagé son positionnement en matière de valorisation et de transmission de savoirs historiques : l’interprétation et la recréation sont ici revendiquées dans la mesure où l’Histoire est toujours partielle et située. Dans ce sens, les récits et les objets sont mis en perspective avec le contexte dans lequel ils ont été produits, donnant ainsi davantage d’éléments de compréhension aux visiteur.ses et laissant une place aux enrichissements.
Quant à la co-création de projet, peut être cité le format des balades patrimoniales comme expérimenté par plusieurs CCR : le CCR d’Ambronay (à l’occasion des journées européennes du patrimoine 2025), le Château de Goutelas, la Ferme de Villefavard ou encore l’Abbaye de Noirlac. Ces exemples ont été l’occasion pour l’ACCR de présenter le livret pratique sur les valeurs des patrimoines pour la société, créé dans le cadre de la formation « Interpréter et appliquer les principes de la Convention de Faro ».
Dans cette attention à considérer les usager.es et les habitant.es davantage comme des personnes avec des besoins, des envies et des savoirs que comme des simples publics cibles, le traitement apporté à l’accueil de tous et de toutes a fait l’objet de plusieurs points d’entrée : quel accueil réserver aux stagiaires et apprenti.es ? quel modèle de gouvernance ? quels liens avec les acteurs de l’hospitalité au sein du territoire ?
/ À quoi ressemble une visite au XXIème siècle ?
Les participant.es ont aussi eu l’opportunité d’échanger longuement sur les approches et formats des visites de sites patrimoniaux à imaginer au XXIème siècle. Écoute, adaptabilité et complémentarité des propositions sont les mots clés de cette réflexion.
Par exemple, si le souhait de s’éloigner des formats de visites guidées descendantes pour aller vers quelque chose de plus participatif, voire coopératif comme les balades patrimoniales, a été exprimé, il convient aussi de reconnaître que ce modèle plait et suppose de nombreuses compétences et qualités de la part du guide.
De nombreuses questions ont alimenté les discussions : le discours doit-il partir du lieu ou des personnes ? faut-il les déstabiliser en provoquant la curiosité sur des points inattendus ou répondre uniquement aux attentes ? comment respecter l’intelligence des publics lors d’une visite classique ? qu’est-ce qui est intéressant à transmettre et qui le définit ? quelle expérience sensible, poétique laisse-t-on ? quelle place laissée au silence et à la flânerie ? comment s’extraire du site pour créer des ponts avec l’extérieur et le contemporain ? comment travailler les relations et la convivialité ? comment trouver le juste milieu entre transmettre un savoir et laisser la place pour en recevoir ? comment démystifier la posture du médiateur ?